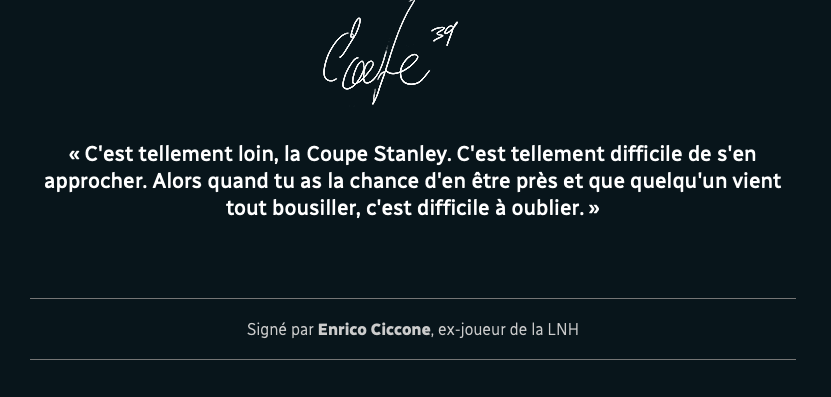- CICCO en veut encore à Jeremy Roenick...
- Pour lui avoir VOLÉ la COUPE STANLEY...
Un mot. Une phrase. Et tout peut basculer.
Je n’ai jamais été du genre à mettre la faute sur les autres. Je me suis toujours responsabilisé, et j’ai toujours été dur envers moi-même.
Mais pour un seul événement dans ma vie, même si je ne ressens plus d’amertume aujourd’hui, je l’admets : je montre du doigt une personne en particulier.
C’est tellement loin, la Coupe Stanley. C’est tellement difficile de s’en approcher. Alors quand tu as la chance d’en être près et que quelqu’un vient tout bousiller, c’est difficile à oublier.
Le 20 mars 1996, date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey. Sur le coup de 15 h, je laisse échapper un soupir de soulagement : l’heure fatidique est passée et tout indique que je resterai avec le Lightning de Tampa Bay. Je pars faire une sieste.
À 17 h 15, mon téléphone sonne. C’est le directeur général Phil Esposito. Il m’a échangé aux Blackhawks de Chicago, il a simplement fallu quelques minutes supplémentaires pour que la transaction soit approuvée par le bureau de la ligue, ce qui explique qu’on m’en fasse l’annonce aussi tard. J’ai le coeur brisé. J’aimais bien Tampa, et j’aimais bien notre équipe.
Je demande à Phil ce que le Lightning obtient en retour de mes services : l’attaquant Patrick Poulin, le défenseur Igor Ulanov et un choix de 2e tour au prochain repêchage.
« Un 2e choix?, que je lui réponds. Hé boy! Moi aussi, je me serais échangé! »
Je discute ensuite avec mon nouveau patron, le directeur général des Blackhawks Bob Pulford. Il ne veut plus que son capitaine et meilleur défenseur, Chris Chelios, passe son temps au banc des pénalités à force de défendre ses coéquipiers. Il m’explique que je jouerai en sa compagnie.
À Chicago, je joins toute une équipe de hockey : Chelios, Tony Amonte, Jeremy Roenick, Bernie Nicholls, Éric Dazé, Joe Murphy, Gary Suter, Ed Belfour.
Mais au-delà du talent, les Blackhawks forment une équipe qui se tient, et Chelios en est le leader incontesté. Jamais il n’aurait accepté qu’un joueur ne vienne pas en aide à un coéquipier, en aucune circonstance.
Je me souviens entre autres d’un incident en particulier, où j’encaisse une mise en échec un peu cheap, par derrière. Je laisse immédiatement tomber mes gants, mais en me retournant, Amonte et Nicholls se sont déjà rués sur mon assaillant. Je les rejoins quelques instants plus tard au banc des pénalités et je leur demande : « Voyons les gars, c’est pas moi qui suis sensé faire ce travail-là? Ne faites pas ça voyons! » Mais ils me répondent aussitôt que ce n’est pas comme ça que ça fonctionne à Chicago.
Chris n’aurait jamais laissé passer qu’un de ses joueurs ne se tienne pas debout pour les autres. Pour lui, c’est clair : l’équipe passe toujours en premier. Les individus n’existent pas dans ce vestiaire. Ça tombe bien, ça a toujours été ma philosophie.
J’ai déjà vu un Suédois entrer dans le vestiaire avec une visière, et Chris se diriger aussitôt vers lui avec un tournevis pour la lui enlever. Ici, on ne joue pas avec une visière. Ici, on est des guerriers.
Chris Chelios Bl Photo : Getty Images/Jamie Squire
À l’aube des séries éliminatoires, la grande majorité des experts nous prédisent la finale de la Coupe Stanley.
Dans ma tête, je m’y vois déjà. On va gagner. Ça va être incroyable.
Voilà enfin ma chance.
Et comme prévu, nous commençons en force en éliminant les Flames de Calgary au premier tour dans un balayage de quatre matchs.
Les astres semblent alignés en notre faveur.
La série suivante, contre l’Avalanche du Colorado, commence merveilleusement bien pour nous. Tout nous sourit.
Dès le départ, on a le sentiment que Patrick Roy, qui a été échangé par le Canadien à peine quelques mois auparavant, n’est pas dans son assiette. En fait, il ne l’a pas du tout. Il n’arrête pas un ballon de plage, au point où c’est moi, Enrico Ciccone, qui marque le premier but de la série!
On domine l’Avalanche à Denver, malgré le score serré de ce premier match (3-2 en prolongation).
Le jour du deuxième affrontement, huit de nos joueurs sont frappés par un empoisonnement alimentaire. De mémoire, trois d’entre eux n’endossent pas l’uniforme le soir venu, les autres jouent malades. Notre gardien réserviste, Jeff Hackett, remplace Ed Belfour. On perd 5-1, mais on a une excuse : nos gars étaient malades.
De retour à Chicago, Patrick éprouve encore des difficultés. Ça se voit. On gagne le match numéro 3 encore une fois en prolongation. Tout va bien. On se sent en plein contrôle de la situation.
Puis, lors du 4e match, Roenick se retrouve presque seul devant Roy. Ennuyé par le défenseur Sandis Ozolinsh, il n’arrive pas à marquer. Malgré les protestations de Roenick, l’arbitre Andy van Hellemond n’appelle ni pénalité ni lancer de punition.
Finalement, Joe Sakic marque en 3e période de prolongation pour faire gagner l’Avalanche. La série est égale, 2-2.
Après le match, les journalistes vont voir Patrick pour lui demander sa version de l’échappée de Roenick. Il répond simplement qu’il aurait stoppé l’attaquant des Blackhawks même s’il n’avait pas été accroché par Ozolinsh.
Jeremy Roenick a toujours attiré les caméras. Il les a toujours aimées aussi. Il pouvait passer dans le vestiaire, en ressortir puis, si les journalistes ne l’avaient pas approché, il revenait, puis revenait encore. Il est fait comme ça, J.R.. C’est un extraverti.
Le lendemain du 4e match, les journalistes l’entourent dans le vestiaire et reviennent sur l’histoire de l’échappée de la veille.
C’est là où Jeremy tombe dans le panneau.
« Pas de doute, ça méritait un lancer de pénalité. J’aime bien quand il (Patrick) dit qu’il m’aurait arrêté de toute façon. J’aimerais bien savoir où il était lors du 3e match. Probablement en train de chercher son jock-strap. »
Il n’y avait pas encore de médias sociaux à l’époque. N’empêche, la citation se met à jouer en boucle sur ESPN, partout. Immédiatement, les journalistes mettent Patrick au courant de la réplique de Roenick.
Le gardien offre alors une citation qui deviendra célèbre dans le monde du hockey : « Je ne peux pas entendre ce que dit Jeremy, j’ai mes deux bagues de la Coupe Stanley qui me bouchent les oreilles. »
Quand j’entends cette réponse un peu plus tard, je me dis intérieurement que c’est une excellente réplique.
Mais je ne réalise pas, sur le coup, ce qui vient d’arriver.
Je vais le réaliser le lendemain matin, dans le vestiaire.
Chris Chelios avait ses habitudes. Il arrivait toujours très tôt à l’aréna, vers 7 h, 7 h 30. Il alternait les séances de bain chaud, de sauna et de bain de glace. Sa petite routine.
Cet avant-midi-là, les gars sont donc dans le vestiaire, comme d’habitude les jours de match.
Soudainement, Chris retontit et se dirige droit vers Jemery Roenick. Et il lui tombe dans la face.
« Imbécile! Mais qu’est-ce que t’as fait? Tu viens de réveiller le meilleur joueur de la LNH! T’aurais pas pu fermer ta gueule? » Je vous évite les blasphèmes...
Chris est tellement fâché que quelques-uns d’entre nous doivent s'interposer pour ne pas que ça dégénère.
J.R., lui, reste J.R.. Il dit qu’il n’y a rien là, que Chris dramatise.
« Hé, j’ai gagné une coupe Stanley avec lui, lui répond aussitôt Chelios en référence à la conquête du Canadien de 1986. Je le connais, Patrick.
« Il dormait. Et toi, tu l’as réveillé. »
Patrick Roy, gardien de l'Avalanche du Colorado, pendant la série contre les Blackhawks de Chicago, au printemps 1996 Photo : sports illustrated/getty images/Tim DeFrisco
Comme de fait. Les deux matchs suivants, on n’a pas touché au puck, et Patrick Roy a tout arrêté.
Ce genre de situation est atroce à vivre. Tu es sur le banc et tu regardes ce qui se passe sur la patinoire… Tu sens que le vent tourne. Pouf, Roy réussit un arrêt spectaculaire. Puis un autre. Et tu te chuchottes à toi-même : « Dites-moi que ce n’est pas vrai. Dites-moi que ce n’est pas en train d’arriver. »
Oui, c’est exactement ce qui est en train d’arriver.
On dit souvent qu’un joueur ne peut gagner une série à lui seul. C’est vrai, à une exception près. Le marqueur de 50 buts ne peut pas gagner à lui seul. Le défenseur étoile ne peut pas gagner à lui seul. Mais le gardien, lui, le peut.
Ce printemps-là, c’est ce qui se produit sous nos yeux.
On perd le 5e match.
Tu retournes chez toi et tu essaies de te convaincre que le vent n’a pas tourné. Puis, le 6e match commence, Patrick réussit un ou deux autres arrêts spectaculaires, et ça continue. Et plus ça continue, moins tu es capable de t’en sortir. Voyant que leur gardien arrête tout, les joueurs de l’Avalanche changent leur façon de jouer. Ils ouvrent la machine : ils savent que leur gardien va se charger du reste. De notre côté, c’est l’inverse. On se met à jouer sur les talons. On commence à hésiter.
À douter.
On dit parfois que le génie frôle la folie. Ça s’applique aussi au hockey. C’est tellement fragile tout ça, le succès et la confiance, que tu es constamment sur la ligne, toujours tout près de perdre tous tes moyens.
Tout ça est psychologique. Tout ça se passe dans la tête.
Et quand le doute s’installe, c’est fini.
F-I-N-I.
L’Avalanche a gagné les 5e et 6e matchs de la série, nous a éliminés, a battu des Red Wings de Detroit en finale d’association, puis est allé balayer les Panthers de la Floride en quatre matchs pour remporter la Coupe Stanley.
La même coupe Stanley que, quelques semaines plus tôt, je me voyais déjà brandir.
Patrick Roy soulève la coupe Stanley le soir du 10 juin 1996, après avoir vaincu les Panthers de la Floride. Photo : Associated Press/Hans Deryk
C’est peut-être là l’histoire de hockey qui m’a marqué le plus, l’histoire qui m’a servi le plus pendant ma carrière, et l’histoire qui a le plus servi à tous les joueurs que j’ai côtoyés par la suite, que ce soit en tant que coéquipier, qu’agent de joueur, qu’analyste ou que conseiller auprès des jeunes.
Souvent, j’ai entendu des journalistes et analystes déplorer le fait qu’en séries éliminatoires, les joueurs ne disent rien, ou sortent la fameuse « cassette ». Croyez-moi, je les comprends. Un mot, une phrase mal placée ou mal interprétée, un article, ou même simplement un titre, et le faux pas en question sera piqué au babillard du vestiaire de l’équipe adverse par l’entraîneur pour motiver ses troupes. Ça a toujours existé. Ça fait partie des tactiques. Parmi elles, il y a aussi le fait de provoquer l’adversaire, question de l’inciter à dire quelque chose qui pourrait le mettre dans le pétrin.
Ce n’est un secret pour personne : il y a la game qui se joue sur la glace, et il y a l’autre game. Celle qui se joue dans la tête de l’adversaire. Et cette game-là s’apparente à un jeu d’échecs.
L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock, est devenu le maître de ce jeu-là. On va souvent l’entendre encenser l’adversaire et même dire que le meilleur joueur des Leafs, au contraire, éprouve des difficultés. Tout cela est arrangé, bien sûr. Il n’irait pas descendre ainsi son meilleur joueur devant les journalistes sans l’en avoir prévenu.
Ça fait partie de la game, comme on dit.
Tout cela, au fond, est un art.
J’ai revu Jeremy plusieurs fois depuis, entre autres à l’hiver 2018 : j’étais analyste de hockey pour Radio-Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Il faisait le même travail pour NBC. On a eu du fun.
Je ne lui remets pas cet incident dans la face. J’ai peut-être l’air de l’attaquer ici, mais j’aime bien J.R.. Mais bon, c’est ça qui s’est produit ce printemps-là. Et Jeremy l’avait cherché. Ce n’est pas comme s’il avait fait une déclaration qui, sous le coup de l’émotion, avait dépassé sa pensée. Au contraire, sa déclaration, elle était préparée.
J.R. est un bon gars. Mais, le connaissant, je suis persuadé que, encore aujourd’hui, il ne réalise pas ce qu’il a fait. J’en suis sûr à 100 %.
C’est sa personnalité. Et cette personnalité, elle a fait de lui le grand joueur qu’il a été.
Veux-tu aller à la guerre avec J.R.? Bien sûr que oui. Mais je vais lui mettre une muselière…
Un mot. Une phrase. Et tout peut basculer. Et une série peut virer de bord.
Je l’ai appris au printemps de 1996. Et je ne l’ai jamais oublié puisque, de toute ma vie, c’est la fois où je me suis approché le plus de la Coupe Stanley.
C’était ma chance.